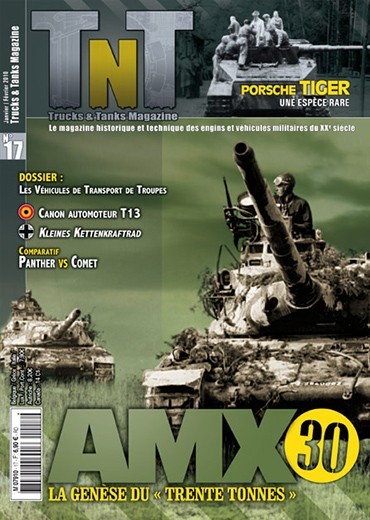
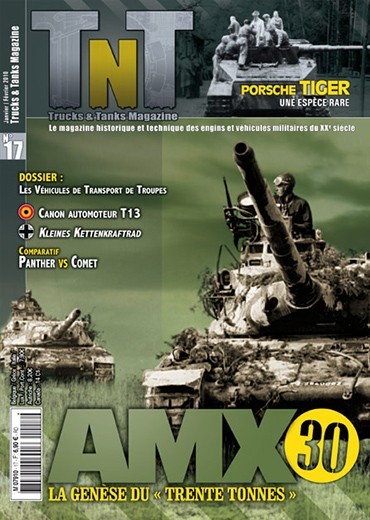

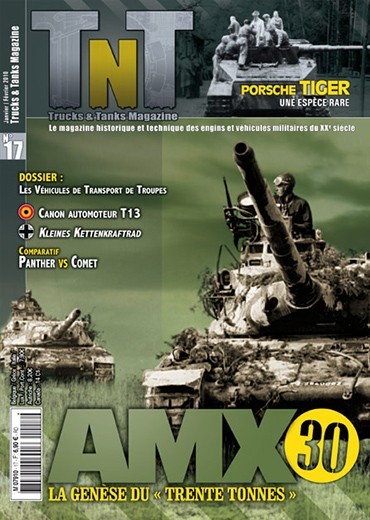
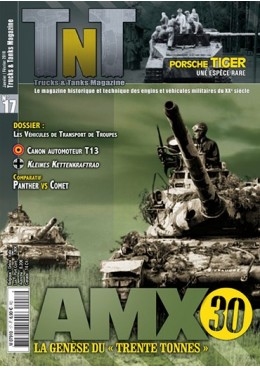
AMX-30
La genèse du « trente tonnes »
EPUISE
Au sommaire du n°17 - Janvier/Février 2010
+ AMX-30
La genèse du « trente tonnes »
+ Kleines Kettenkraftrad
Efficace, mais dangereuse !
+ DOSSIER : Les véhicules de transport de troupes
Les « autobus » du champ de bataille
+ Canon automoteur T13
« Qui veut la paix, prépare la guerre »
+ Porsche Tiger
Une espèce rare
+ Comment ça marche
Les systèmes de pointage et de tir
+ Comparatif :
Panther versus Comet
Au sommaire du n°17 - Janvier/Février 2010
À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, l’Armée française aligne une majorité d’engins américains. Des machines à la fiabilité éprouvée mais qui ont douloureusement marqué le pas face aux Panzer. Etudié durant l’occupation, l’ARL 44, un croisement entre un châssis de B1 bis et un canon de 90 mm, assure un temps la fonction de char de combat. Néanmoins, l’engin n’est qu’une solution temporaire. Le Tiger ayant laissé le champ libre au JS-3 soviétique, équipé d’une pièce de 122 mm, dans les plaines européennes, les Occidentaux cherchent des parades à ce nouveau venu qui rend obsolètes leurs propres matériels. La course à l’armement entre les deux blocs vient de commencer. Muni d’un tube de 120 mm, l’AMX-50 est un moment pressenti. Toutefois, l’Allemagne, que les contraintes logistiques des blindés lourds ont rendue prudente, n’est pas enthousiasmée par un projet commun de ce type. L’avènement de la charge creuse va dans le sens de la Bundeswehr. Aucune cuirasse, aussi épaisse soit-elle, ne semble pouvoir faire obstacle à un obus G. Les deux nations s’orientent, reprenant au passage l’avis exprimé par le général Guderian en 1945, vers un Main Battle Tank de la classe des 30/35 tonnes.
Dans les années 1930, les Fallshirmjägers, ou troupes aéroportées allemandes, sont considérés comme une arme en devenir. Leur capacité à être largués sur les arrières ennemis leur donne un poids tactique considérable. Cependant, une fois au sol, les parachutistes manquent de mobilité, notamment au moment de déplacer leurs matériels « lourds », comme les canons antichars 3,7cm Pak 35/36 ou les obusiers courts. La nécessité de disposer d’un véhicule tracteur de petite taille se fait alors ressentir. L’engin doit, d’une part, pouvoir être transporté par les planeurs DFS et, d’autre part, être en mesure d’emprunter des chemins étroits pour se rendre le plus rapidement possible sur les endroits du front réclamant la présence des pièces qu’il remorque. Une motocyclette semble être d’un gabarit idéal. Toutefois, ses performances limitées sur terrain très meuble représentent un handicap insurmontable. La solution « miracle » passe alors par la greffe d’un train de roulement semi-chenillé.
Appréhendée un temps comme la « reine des batailles », l’infanterie voit son rôle évoluer tout au long du XXe siècle. Mais, plus que sa fonction au feu, c’est la vision que les états-majors ont de leurs soldats qui change. De « taillables et corvéables à merci », ils sont progressivement devenus une ressource qu’il ne fallait plus « gaspiller » sans compter. L’homme ne peut plus être sacrifié vainement sous peine de perdre la guerre. Cette nouvelle notion émerge lentement des champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Le conflit qui se voulait rapide se transforme en un affrontement sanglant où les fantassins de tous bords tombent par milliers sous la mitraille ennemie. Pour limiter autant que faire se peut les hécatombes, l’idée d’un véhicule transport de troupes commence à émerger. L’engin est destiné à vaincre le trinôme infernal : tranchées, barbelés et mitrailleuses. Ce concept mute selon les périodes et les progrès techniques ; cependant, la doctrine reste la même, amener en sécurité l’infanterie au plus près de la ligne de front, comme le ferait un « autobus ». Une fois sur l’objectif, les soldats combattent à pied, retrouvant leur rôle classique.
En 1936, suite à la remilitarisation de la Rhénanie par l’Allemagne hitlérienne, la Belgique, doutant des systèmes de sécurité collective mis en place au lendemain de la Première Guerre mondiale, décide de revenir à sa politique traditionnelle de neutralité. Elle dénonce alors les accords militaires passés avec la Grande-Bretagne et la France, bien que ces deux nations aient confirmé, en avril 1937, leur engagement de prendre part à la défense du pays, en cas d’agression étrangère. Toutefois, l’Armée belge ne reste pas inactive et lance le développement de chasseurs de chars capables de venir à bout des blindés adverses. Ce programme ne remet pas en cause la politique de neutralité menée par Léopold III, car ces engins n’ont qu’une vocation purement défensive.
Grand favori de Hitler, le docteur Ferdinand Porsche est l’un des acteurs majeurs de la guerre industrielle que se livrent les grands groupes d’armement allemands. En effet, les retombées financières sont conséquentes, et un contrat passé avec l’Armée nationale est hautement lucratif. Comme à son habitude, le Doktor présente des machines affichant un savoir-faire de pointe. L’homme n’hésite pas à sortir des sentiers battus afin de coiffer ses concurrents, qui développent des matériels techniquement plus classiques. Le pari est osé pour des véhicules militaires destinés à affronter les « affres » du combat. Pour lui, l’innovation technologique est un véritable moteur, au point que les prises de risque sont devenues une religion. D’ailleurs, son projet de Panzer lourd pour le Tigerprogramm ne déroge pas à cette règle. Mais ce qui a fait le succès de l’ingénieur allemand dans le civil est-il directement transposable dans le domaine militaire ?
Las de subir l’insupportable supériorité technologique des Panzer, les autorités britanniques lancent, en septembre 1943, un successeur au très perfectible Challenger. Malheureusement pour les équipages, la nouvelle mouture du plus puissant des Cruiser est difficile à mettre au point. Un retard qui tombe bien mal pour les Armoured Division. En effet, quelques mois auparavant, les plaines russes ont vu apparaître un des plus redoutables prédateurs que le théâtre d’opérations européen ait connu : le Panther. Les rapports soviétiques soulignent sa puissance de feu ainsi que son épais blindage. Appelé à devenir le char de bataille principal de la Panzerwaffe, le nouveau venu est supérieur à tous les tanks britanniques en service. En effet, alors que le Sd.Kfz. 171 intègre les derniers raffinements techniques de l’époque, les machines anglaises sont toutes conçues selon des théories d’avant-guerre. Il est plus que temps que l’Armée de sa Gracieuse Majesté lui trouve un adversaire à sa taille.
